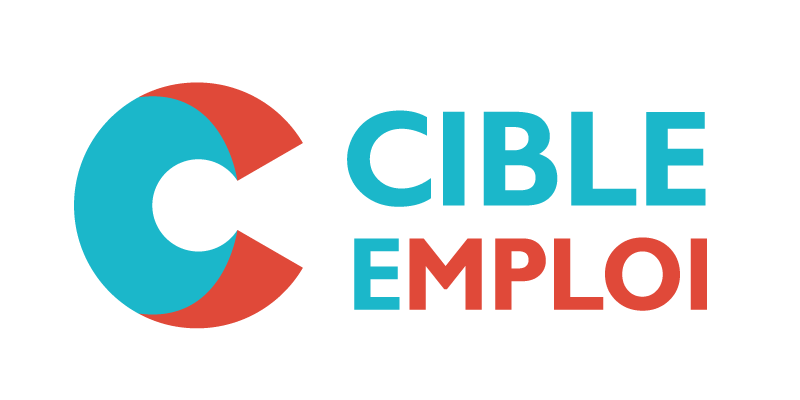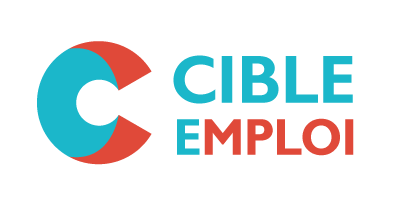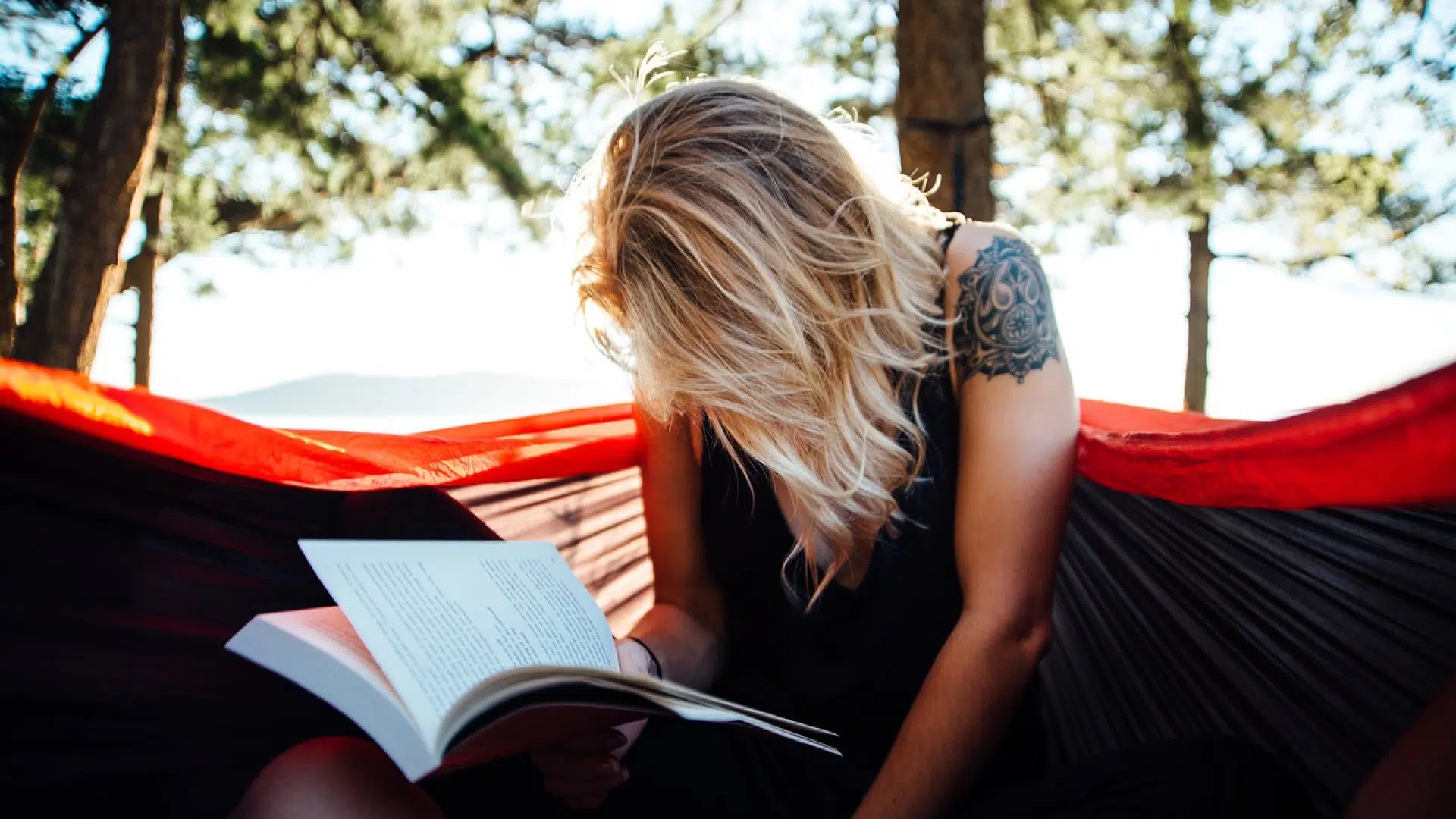Les financements dédiés à la recherche sur la durabilité mondiale représentent moins de 3 % des investissements scientifiques mondiaux, malgré l’urgence croissante des enjeux environnementaux. Les démarches pluridisciplinaires, pourtant nécessaires à l’innovation, se heurtent encore à des structures institutionnelles cloisonnées et à des critères d’évaluation inadaptés.
Pour les nouveaux acteurs, l’accès aux réseaux établis, aux données et aux infrastructures reste limité, accentuant les inégalités de participation. Les avancées récentes montrent toutefois que la révision des modes de collaboration et l’adaptation des politiques de soutien peuvent lever plusieurs barrières structurelles.
Panorama des défis scientifiques majeurs pour la durabilité mondiale
À l’heure où la recherche scientifique sur le développement durable devrait avancer à grands pas, elle se heurte à des murs bien ancrés dans l’organisation académique. À Paris-Saclay ou dans d’autres pôles européens, le quotidien des universités et des grands organismes comme le Cea, l’Inserm ou le Cnrs reste marqué par le cloisonnement disciplinaire. Impossible de saisir la complexité du monde si chaque science travaille dans sa tour d’ivoire : pourtant, les financements restent segmentés, et les critères d’évaluation continuent de privilégier la performance sectorielle au détriment du collectif.
L’Europe tente d’imprimer un nouvel élan. Les programmes comme Horizon Europe misent sur des appels à projets transversaux et la multiplication des passerelles entre instituts et entreprises. Mais dans les laboratoires, le changement s’installe lentement. Face à la compétition féroce pour des financements qui ne suffisent plus, les jeunes équipes innovantes peinent à émerger et à s’émanciper des hiérarchies traditionnelles.
Voici les principaux blocages qui persistent dans ce paysage :
- Fragmentation thématique et institutionnelle
- Précarité des financements sur la durée
- Absence d’indicateurs adaptés à l’évaluation des impacts sociétaux
Malgré tout, une énergie nouvelle circule. À Saclay, on voit éclore des mutualisations inédites, des chaires qui croisent les disciplines, et des modèles de gouvernance à l’essai. Ces signaux montrent une capacité d’adaptation réelle, même si la route reste longue pour les chercheurs qui veulent servir la transition écologique sans compromis.
Quels obstacles freinent la recherche vers des systèmes agro-alimentaires durables ?
Sur le terrain de l’agriculture et de l’alimentation durables, d’autres verrous se dressent. L’analyse des données, clé de voûte pour comprendre les effets des pratiques agricoles sur l’environnement, se heurte à la dispersion des bases de données, publiques comme privées. Les équipes de l’Inrae ou des établissements d’enseignement supérieur racontent la difficulté à harmoniser les référentiels, à jongler avec les formats multiples de collecte, et à composer avec des opérateurs privés qui verrouillent l’accès aux données de terrain.
Le nerf de la guerre reste le financement. Les appels à projets émanant des pouvoirs publics privilégient souvent une efficacité à court terme, laissant de côté les approches globales indispensables à la transition. Les chercheurs, piégés dans ce schéma, peinent à inscrire leurs travaux dans la durée. Résultat, les réseaux de recherche s’étiolent, alors qu’ils sont indispensables pour traiter l’enchevêtrement entre agriculture, alimentation et environnement.
Un autre frein se niche dans les critères d’évaluation. Les succès restent jugés à l’aune de publications classiques, sans prise en compte suffisante des retombées sociales ou environnementales. Des biais hérités d’anciennes habitudes disciplinaires écartent encore trop souvent les savoirs locaux ou les pratiques paysannes, pourtant décisifs.
Pour mieux cerner ces défis, voici les blocages spécifiques au secteur :
- Fragmentation des données et des acteurs
- Modèles de financement inadaptés
- Évaluation insuffisante des retombées sociétales
L’avenir de l’innovation dans ce domaine dépendra d’une refonte profonde des processus, à la croisée de la science, des politiques publiques et de l’action locale.
Renforcer l’innovation : leviers et solutions face aux blocages persistants
L’innovation scientifique ne naît pas dans les sentiers battus. Elle requiert d’oser, d’hybrider les disciplines et de sortir des cadres établis. Plusieurs leviers, testés ici et là, montrent déjà leur potentiel, notamment sur des sites pilotes comme Paris-Saclay. Les partenariats public-privé dynamisent la circulation des idées et accélèrent la transformation de la recherche fondamentale en solutions concrètes. Tout l’enjeu : garantir la transparence et l’éthique, sans sacrifier la liberté de la recherche.
L’arrivée massive de l’intelligence artificielle et du machine learning dans la santé, l’agriculture ou l’énergie ouvre des horizons insoupçonnés. Grâce à ces outils, le traitement et l’interprétation des données prennent une nouvelle dimension. Sur le plateau de Saclay, des équipes mêlent aujourd’hui génomique, modélisation et robotique pour inventer de nouvelles pratiques.
Pour soutenir ce mouvement, certains centres misent sur la formation continue et encouragent la mobilité entre secteurs. Cofinancements, échanges entre universités, organismes et entreprises : ces dispositifs stimulent la prise d’initiatives et l’audace. Le dialogue entre scientifiques et pouvoirs publics, en particulier lors de l’élaboration des politiques, joue un rôle décisif pour inscrire les innovations dans la durée.
Pour résumer les pistes qui font la différence :
- Partenariats hybrides : co-construction de projets entre laboratoires et industriels
- Technologies émergentes : intégration de l’IA dans le traitement de données massives
- Mobilité des chercheurs : circulation des expertises entre secteurs
Nouveaux acteurs de la recherche : quelles difficultés spécifiques et comment les surmonter ?
L’arrivée de nouveaux acteurs dans la recherche bouscule les lignes. On voit émerger des profils issus des sciences humaines et sociales, des disciplines variées, une pluralité de langues. Cette diversité, encouragée par l’Unesco et présente de Lyon à New York, met à l’épreuve les habitudes du monde académique. Mais elle n’est pas sans embûches. Les grilles d’évaluation, pensées pour les sciences exactes, peinent à reconnaître la valeur des démarches interdisciplinaires ou des articles publiés en français, anglais, espagnol. La diversité linguistique se heurte à la domination persistante de l’anglais scientifique, limitant parfois la diffusion des avancées.
Les institutions, qu’elles soient universitaires ou issues de la recherche publique, tardent à s’ouvrir à cette hétérogénéité. Les dispositifs d’aide, de financement ou de valorisation restent souvent calqués sur un modèle uniforme, centralisé. Pourtant, la montée en puissance de réseaux transnationaux, appuyée par les programmes européens, pousse à repenser la gouvernance et la circulation des savoirs. Les échanges entre chercheurs, facilitateurs et décideurs ouvrent la voie à des solutions sur mesure.
Voici les leviers qui permettent d’accompagner ces évolutions :
- Reconnaissance des publications multilingues : prise en compte dans les évaluations institutionnelles.
- Dispositifs de mentorat : appui spécifique aux jeunes chercheurs issus de filières mixtes.
- Dialogue avec les pouvoirs publics : intégration des sciences humaines dans l’élaboration de politiques fondées sur la recherche.
La montée de ces nouveaux profils oblige à revoir nos schémas d’évaluation. Encourager la diversité sans rien céder sur la rigueur : voilà le défi pour bâtir une recherche qui tienne la route, face à l’urgence de la transition.